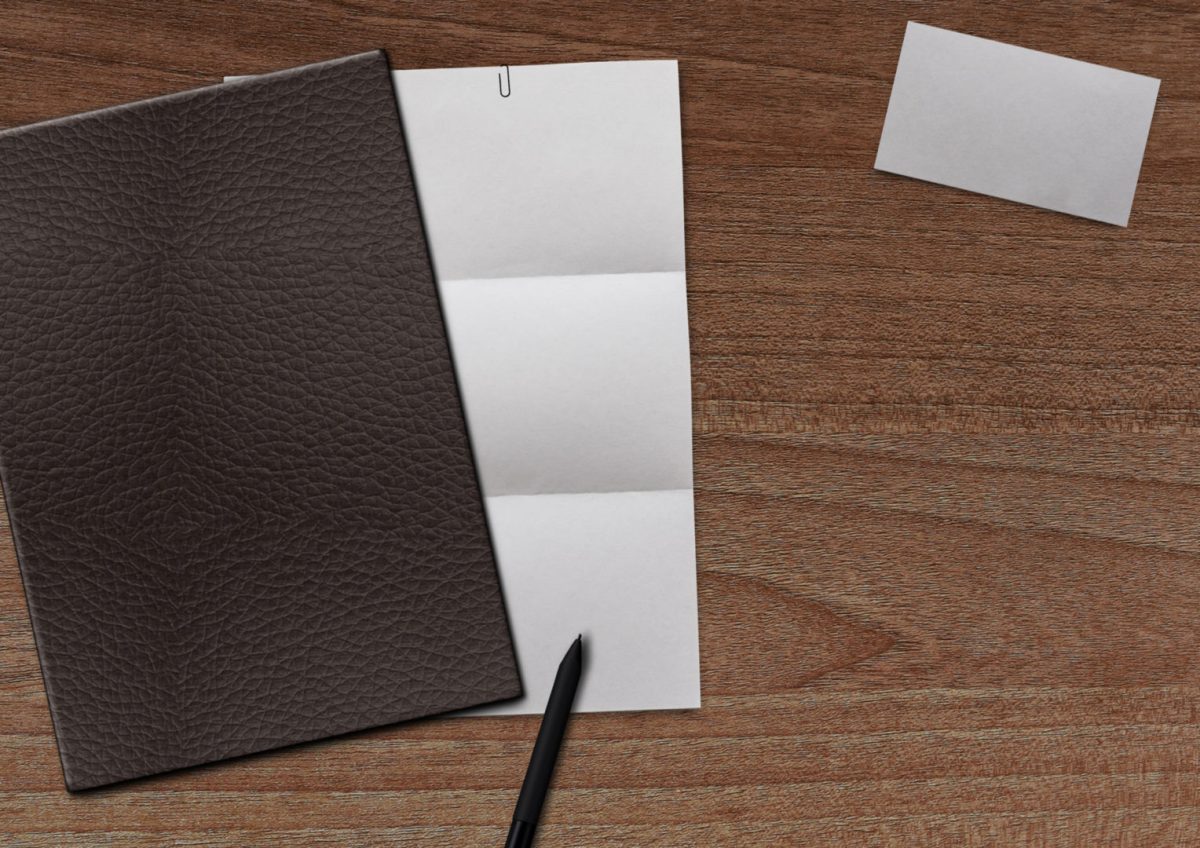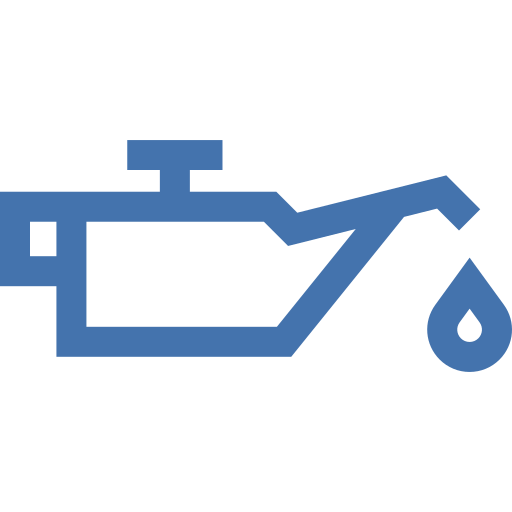Un papier, même tamponné, ne fait pas toujours la loi. Plus d’un acquéreur tombe des nues en découvrant que le fameux certificat administratif, présenté comme le sésame ultime, ne garantit pas toujours la tranquillité d’esprit. Derrière chaque signature, c’est toute la mécanique de la propriété foncière qui se joue, entre formalités officielles et failles bien réelles.
Le Master AGBEMEBIA exerce la profession de notaire depuis janvier 2006.
Son étude, installée à Lomé au 461, avenue Nicholas Grunitzky, fait figure de repère pour ceux qui veulent s’y retrouver dans la jungle des transactions immobilières. Avec une équipe de cinq personnes, le cabinet veille à enregistrer bâtiments et titres fonciers, une étape indispensable pour donner du poids à chaque vente et éviter les mauvaises surprises.
Mais lorsqu’on se lance dans l’acquisition d’un terrain, une question revient sans cesse : quel document atteste vraiment que la parcelle vous appartient ?
Un seul document fait foi : le titre foncier. C’est lui et lui seul qui atteste légalement du droit de propriété.
Pourtant, tout le monde n’a pas ce précieux papier en main. Alors, à défaut, quel document réclamer au vendeur ?
Le strict minimum, c’est le certificat administratif.
Mais alors, qu’est-ce qui se cache derrière ce document ?
Le certificat administratif, délivré par la préfecture, atteste que des agents se sont déplacés, du moins en théorie, sur le terrain et ont mené des vérifications pour s’assurer que le vendeur est bien le propriétaire du bien en question.
En pratique, la situation est souvent plus trouble qu’il n’y paraît. Il n’est pas rare que plusieurs personnes se retrouvent avec un certificat administratif pour la même parcelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que la délivrance de ce document peut parfois se faire sur simple demande, sans réelle vérification sur le terrain ni inscription dans les registres. Résultat : un même terrain peut être vendu plusieurs fois, chacun détenant un certificat aussi officiel en apparence que fragile juridiquement.
Face à ce risque, la vigilance s’impose. Le notaire avertit systématiquement ses clients : le certificat administratif n’offre pas toujours les garanties espérées. Il arrive même qu’après vérification dans les registres, le fameux document soit inexistant ou tout simplement introuvable.
Dans ce contexte, peut-on vraiment dire que les transactions foncières sont sécurisées ?
La réalité, c’est que le marché reste miné par les litiges. Les forums sur la sécurité des transactions se multiplient, les conférences aussi, mais les affaires qui atterrissent devant les tribunaux ne cessent d’augmenter. L’incertitude règne, faute de procédures fiables et de contrôles systématiques.
La racine du problème tient à un point précis : l’absence de titre foncier. Des terrains changent de mains sans que le document officiel n’existe. Un même lopin peut ainsi se retrouver au cœur de plusieurs ventes, chacun des acquéreurs pensant avoir fait une bonne affaire. Ce manque de rigueur alimente le contentieux foncier de façon continue.
Mais que se passe-t-il lorsque le terrain dispose, cette fois, d’un titre foncier ?
Dans ce cas, tout commence par un audit obligatoire, notamment pour les terres protégées à Lomé. L’objectif : vérifier que le bien appartient bien au vendeur et qu’aucune hypothèque ne pèse sur le terrain. Si tout est conforme, l’acheteur peut acheter en confiance. Le notaire prend alors en charge la rédaction et l’enregistrement de l’acte de vente. Il s’occupe également du reçu et du contrat de vente, puis dépose la demande de transfert du titre au nom de l’acheteur à la conservation des terres. Ce passage de relais officialise la mutation du titre foncier.
Mais tout cela se passe-t-il exclusivement chez le notaire ?
Dès lors qu’un titre foncier existe, le notaire prend la main sur l’ensemble de la procédure, de la vérification jusqu’au transfert définitif du titre au nom du client. Deux opérations rythment l’affaire : d’abord, contrôler la solidité et la fiabilité du terrain ; ensuite, s’assurer que le titre foncier change bien de main. Pour les parcelles sans titre foncier, la prudence est de mise : il vaut mieux passer son chemin, sauf à assumer les conséquences. Dans ce cas, le notaire exige une reconnaissance écrite du risque, signée par l’acheteur, qui le décharge de toute responsabilité. Un garde-fou indispensable lorsque la tentation de l’achat rapide supplante la sécurité juridique.
Et si l’on souhaite aller plus loin et déléguer le suivi de la construction de sa maison, le notaire peut-il s’en charger ?
La réponse est nette : ce rôle revient à l’architecte ou à l’ingénieur. Le notaire, lui, reste dans son domaine : garantir la transaction, veiller à la conformité des documents et s’assurer que le titre foncier porte bien le nom de l’acquéreur. Sa mission s’arrête là, mais elle n’en demeure pas moins décisive pour la sécurité de l’opération.
Au bout du compte, acheter sans titre foncier, c’est avancer sur un terrain mouvant. Un choix qui peut coûter cher, car dans cette partie, seul le document officiel vaut signature. Les apparences administratives n’ont jamais fait une propriété inattaquable.